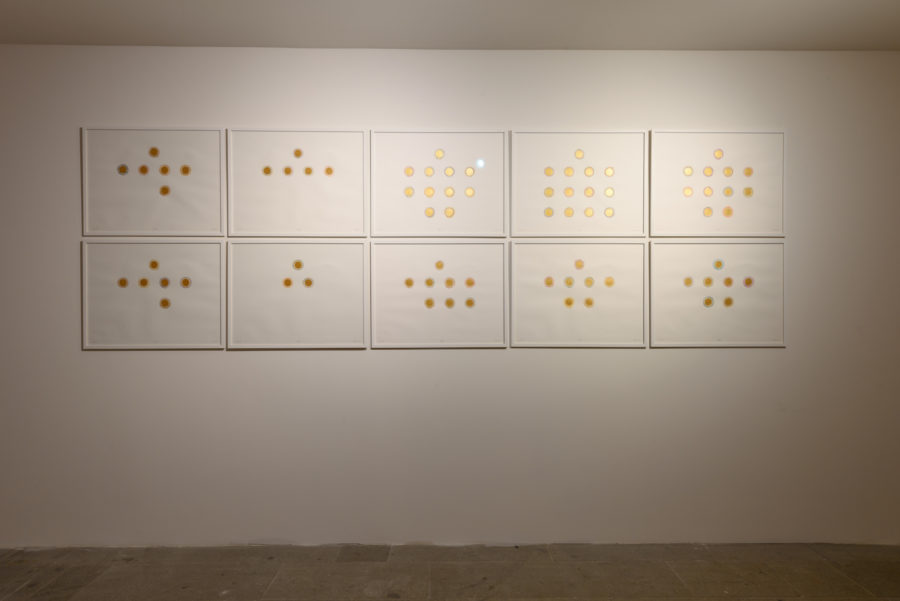I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019
7 000 €

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013
14 000 €

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013
14 000€






















Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022
Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal
100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)
[+]Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022
Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal
100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)
[-]{Renseignement}
Tâqiya-Nor, 2017
Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier
50 x 65 cm (chacun)
106 x 343 cm (total)
Unique
Tâqiya-Nor, 2017
Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier
50 x 65 cm (chacun)
106 x 343 cm (total)
Unique
{Renseignement}
Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019
Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag
100 x 150 cm
Edition de 5 +1AP
Edition disponible : 1/5
Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019
Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag
100 x 150 cm
Edition de 5 +1AP
Edition disponible : 1/5
{Renseignement}
If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021
Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois
24,5 x 23 x 12,5 cm
Unique
If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021
Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois
24,5 x 23 x 12,5 cm
Unique
{Renseignement}
I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019
Eau, papier soluble, encre, flacon en verre
[+]I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019
Eau, papier soluble, encre, flacon en verre
[-]{Renseignement}
Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)
Edition de 5 + 2AP
Edition disponible : 1/5
Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)
Edition de 5 + 2AP
Edition disponible : 1/5
{Renseignement}
Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
{Renseignement}
Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
{Renseignement}
Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023
Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
2/5
Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023
Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
2/5
{Renseignement}
Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}
Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}
Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}
Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}
Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011
tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)
[+]Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011
tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)
[-]{Renseignement}
Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)
[+]Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)
[-]{Renseignement}
24/7, 2019
26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier
[+]24/7, 2019
26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier
[-]{Renseignement}
24/7, 2019
6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)
[+]24/7, 2019
6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)
[-]{Renseignement}
Qubba, 2019
Photographie; 70 x 110 cm
3/5
Qubba, 2019
Photographie; 70 x 110 cm
3/5
{Renseignement}
La Mort dans l’Âme (20), 2021
Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)
[+]La Mort dans l’Âme (20), 2021
Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)
[-]{Renseignement}
La Mort dans l’Âme (5), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
[+]La Mort dans l’Âme (5), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
[-]{Renseignement}
La Mort dans l’Âme (3), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
[+]La Mort dans l’Âme (3), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
[-]{Renseignement}
Beyond the Yellow Haze, 2018
Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150
[+]Beyond the Yellow Haze, 2018
Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150
[-]{Renseignement}

Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022
Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal
100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)
{Renseignement}
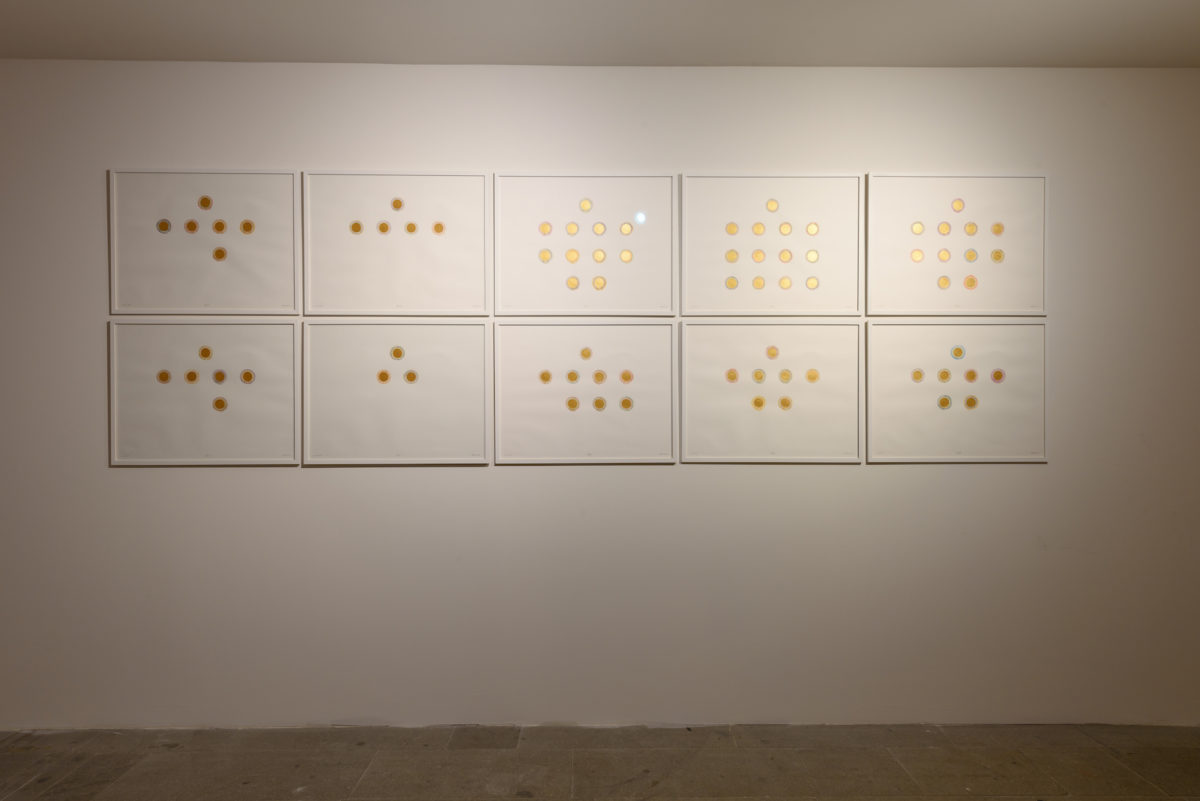
Tâqiya-Nor, 2017
Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier
50 x 65 cm (chacun)
106 x 343 cm (total)
Unique
{Renseignement}

Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019
Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag
100 x 150 cm
Edition de 5 +1AP
Edition disponible : 1/5
{Renseignement}

If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021
Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois
24,5 x 23 x 12,5 cm
Unique
{Renseignement}

I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019
Eau, papier soluble, encre, flacon en verre
{Renseignement}

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)
Edition de 5 + 2AP
Edition disponible : 1/5
{Renseignement}

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
{Renseignement}

Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 (encadrée)
Édition de 5 + 2AP
Édition disponible : 1/5
{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023
Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
2/5
{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023
Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 cm
1/5
{Renseignement}

Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011
tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)
{Renseignement}

Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013
Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g
83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)
{Renseignement}

24/7, 2019
26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier
{Renseignement}

24/7, 2019
6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)
{Renseignement}

Qubba, 2019
Photographie; 70 x 110 cm
3/5
{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (20), 2021
Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)
{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (5), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (3), 2021
Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)
{Renseignement}

Beyond the Yellow Haze, 2018
Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150
{Renseignement}